Nos défaites de Jean-Gabriel Périot
Le réalisateur Jean-Gabriel Périot est comme dans la
Commedia dell’arte un Arlequin pas assez riche pour se vêtir d’une seule pièce.
Alors, il va puiser dans les films des autres pour se fabriquer une
filmographie constituée de fragments récupérés. Observateur des moindres
failles et contradictions du monde dans lequel il vit, il dresse un portrait
implacable de notre société. Un réalisateur qui avance masqué pour donner aux
visages qu’il filme (les détenus, les minorités, les victimes de la guerre, les
individus en recherche d’emploi…) la visibilité et la voix qui leur manquent.
La sortie en salle de son dernier film documentaire Nos défaites s’inscrit dans la lignée de
ses films précédents. On y retrouve comme point de départ les films d’archives,
matière première de prédilection qu’il opère avec une précision chirurgicale
tant ses coupes au montage sont maîtrisées. Dans le court métrage Eût-elle été criminelle … (2016), la
première apparition d’une femme malmenée par la foule de la Libération reste
suspendue aux bords du cadre. Présence incertaine pendant quelques secondes de
cette femme accusée d’accointance avec l’ennemi, filmée par une caméra devenue
tranchante comme un couperet. L’exclusion et le bannissement sont dits par
cette maladresse du cadrage qu’on devine fortuite mais qui prend brusquement un
sens dramatique quand on devine que cette foule exhibe quelqu’un tenu délibérément à distance. Le cinéma de Périot
est condensé là, par ce que l’on refuse de voir et qui reste aux bords de
l’abîme, une présence-absence des « invisibles »
où qu’ils soient.
Interroger les colères
de l’Histoire
Il y a dans le bouillonnement des révoltes l’espoir
d’un monde plus juste. Dans le court-métrage The Devil (2012), le mouvement des Black Panthers montre sur la musique du tourangeau Boogers la
lutte des afro-américains dans les années cinquante pour leurs droits civiques.
La répétition de la phrase If you look upon my face, you are watching
now the Devil (Si tu regardes mon visage, tu regardes maintenant le diable)
sert de leitmotiv aux images. Des extraits de déclarations de membres du Black
Panther Party prennent progressivement la place laissée par la phrase de
Boogers qui agit comme un tempo jusqu’à la fin du film. Une pulsation qui
modifie durablement notre rapport à ces images de femmes et d’hommes qui transforment
leur militantisme pacifique en lutte armée. Dans ses conversations,
Jean-Gabriel Périot avec le professeur de philosophie Alain Brossat [1], explique
que ce changement de stratégie a contribué à répandre l’image de Noirs « violents » alors qu’ils ne
se sont jamais réellement servis des armes
« sauf, très rarement, pour
se défendre d’attaques de la police ». Le réalisateur déclare :
«
Cette prise d’armes a aussi été fortement symbolique : elle a permis à
ceux et à celles qui se sont armés (et par ricochet aux Afro-Américains en
général) d’affirmer un statut qui jusque-là leur était dénié. Les Afro-Américains
étaient acceptés dans la société nord-américaine à l’unique condition qu’ils
restent silencieux ; là, ils ont clairement montré que le jeu avait changé
et qu’il faudrait dorénavant traiter avec eux d’égal à égal. Cependant, il n’a
pas été simple de prendre les armes… C’est ce que montrent la plupart des
images documentaires sur les Panthers y compris celles qu’on voit dans The
Devil. Il y a de la maladresse dont les corps réagissent au maniement des armes
et à la militarisation du mouvement. On voit clairement qu’il s’agit de
« jouer à faire la guerre », on reste dans une mise en scène de soi
et il n’est jamais si facile de tenir, corporellement son rôle. Cependant,
l’important n’était pas de devenir militaire de carrière, mais de montrer que
l’on pouvait jouer à ce jeu-là. Et cela aura suffi à ce que leurs adversaires
construisent cette image d’eux qui est encore la plus répandue : les
Panthers étaient une bande de Noirs « violents », et cette
« violence » est devenue l’argument massue pour les sortir de
l’émancipation noire-américaine, alors même qu’ils en sont un maillon
essentiel.»[2]
L’amateurisme et l’improvisation de cette prise
d’armes que révèlent les images d’archives de The Devil nous intéressent
plus que le passage à l’acte des Black Panthers à la lutte armée. Il y a dans
ce jeu de prendre la peau de l’autre plus qu’un mimétisme stérile pour faire
peur (les Noirs auraient adopté la violence des Pigs blancs qui les bastonnaient et les réprimaient pour se faire
entendre à leur tour) mais la
revendication d’une égalité (maintenant symboliquement, nous combattons à armes
égales). En prenant les armes, les Noirs ne deviennent pas les acteurs d’une
violence qu’ils condamnent mais ils renvoient aux blancs qui les oppriment le
miroir de leurs agressions. Ce procédé d’aller sur le terrain de l’autre pour
revendiquer ses droits semble récurrent chez le réalisateur qui réitère sa
démarche avec des lycéens de 1ère option cinéma du Lycée Romain
Rolland à Ivry-sur-Seine.
Remake
du film La salamandre d’Alain Tanner
(1971), Météore Films
Pour provoquer un dialogue et une réflexion, il ne
faut pas seulement connaitre le discours de l’autre mais pouvoir s’identifier à
lui. C’est cette maïeutique que le réalisateur tente de mettre en œuvre avec
des lycéens a priori éloignés des luttes de post-68. Lors d’un entretien, Jean-Gabriel Périot
explique sa démarche avec ces lycéens :
« Je
voulais leur faire découvrir un des aspects pour moi le plus important du
travail de cinéaste : la possibilité qu’offre le travail d’un film de se
confronter à ce que l’on ne connait pas, de rencontrer des gens qui nous sont
encore, pour des raisons différentes, étrangers, d’affronter l’altérité et de
la défaire. Le point de départ de mon projet fut donc simplement de permettre à
ces adolescents de se confronter à l’inconnu. Et le cinéma engagé des années
post-68 m’est apparu comme un moyen de justement les mettre en face de quelque
chose qui pouvait leur semblait éloigné de leurs préoccupations habituelles.»[3]
Remake
de la Reprise du travail aux usines Wonder, documentaire de 1968, Météore Films
Remake
de films des années 60 -70 par des lycéens d’aujourd’hui
Après plusieurs jours de visionnage du film, le
souvenir du discours d’une gréviste des usines Wonder réclamant des conditions
de travail plus dignes et refusant de réintégrer son poste après le vote de la
reprise reste vivace.
« Non, je ne rentrerai pas,
je ne foutrai plus les pieds dans cette taule, c'est trop dégueulasse ! »
La même gouaille rageuse anime Isabelle, une des
lycéennes qui reprend le rôle. Le temps s’abolit et on est de nouveau sur place
en train de revivre la lutte de cette jeune ouvrière. Le dispositif peut d’abord surprendre. Quelle
légitimité peuvent avoir des lycéens qui ne sont pas encore dans la vie active à
incarner des travailleurs ? Pas plus que celle de jeunes sans grande
expérience affective qui lisent avec leur prof de français Madame Bovary ou Le rouge et le noir à 16 ans. Tout
enseignant sait d’expérience qu’on apprend mieux sur l’endroit où on vit quand
on se déplace ailleurs. La réflexivité qui consiste en un aller vers les représentations
de l’autre pour un retour à soi de ses propres représentations est une des
conditions pour apprendre. Plus que par mimétisme, Périot permet à ces jeunes
d’expérimenter la possibilité de leur discours. Peu importe le tâtonnement du
langage, l’approximation des idées voire même parfois leur caractère consensuel,
la lucidité de l’un et la naïveté de l’autre, ces jeunes apprennent à dominer
leur peur de ne pas savoir pour oser s’exprimer. Galvanisés par ces témoins de l’histoire dont ils rejouent
les luttes, les lycéens parlent en leur nom propre, le réalisateur prenant le
soin de ne pas filmer un débat entre eux mais les interviewant séparément pour
faire émerger leur individualité. Le cinéma engage ces jeunes à prendre chacun
la parole et à dire face caméra je
pense, je suis, j’imagine … dans un monde où leur parole reste peu audible, si
l’on excepte la prise de parole courageuse de Greta Thunberg.
Répétition
des séquences de films des années 60 -70 rejouées par différents lycéens
Au-delà de l’anniversaire des cinquante ans de mai
68, qu’est-ce qui peut encore interpeller les jeunes d’aujourd’hui dans les
combats de cette époque ? Périot couve-t-il le secret espoir d’une
jeunesse qui s’insurge là où ses contemporains se seraient résignés ou fait-il
le constat amer d’une génération d’adultes qui n’a pas réussi à transmettre à
ses enfants le sens des luttes collectives ? Mai 68 est porté par un
souffle insurrectionnel qui n’était pas prémédité et Périot sait bien qu’on ne
fait pas deux fois la même révolte. Son propos semble ailleurs. En faisant
rejouer par les lycéens les évènements autour de 68, il ne dit pas que
l’histoire doit ou pourrait se répéter. Il redonne à ces jeunes la conscience
que le cinéma est un moyen de s’inscrire dans une action collective. Si cette
jeune ouvrière nous touche tant encore aujourd’hui, c’est parce que son combat
est encore actuel et que la caméra rend palpable cette constance des luttes
sociales entre hier et aujourd’hui. Le film témoigne certes du passé mais il ne
trouve sa finalité que dans sa projection publique et une prise de conscience
actualisées. A chaque projection, les films réactivent quelque chose qui surgit
devant nous dans l’instant. Le cinéma ne connait pas de temps mort et figé. Le
défilement des images est plus qu’une mécanique, c’est une leçon de vie. Le
cinéma prend l’histoire en marche et Périot entraine les lycéens dans une
pensée en mouvement. Penser au cinéma, c’est d’abord incarner des paroles. Une
démonstration certes ici efficace mais parfois un peu trop réfléchie pour permettre
au spectateur de se projeter dans une autre logique, celle pour nous aussi des
sensations. Ce qui ne retire rien au film de sa valeur de témoignage mais rend
abrupt et sans concession son propos.
Une
lycéenne répondant aux questions du réalisateur dans Nos défaites, Météore Films
L’alternance du noir et blanc et d’images en
couleurs lie le passé au présent, faisant de ces portraits de jeunes
d’aujourd’hui un film bigarré qui invite à la diversité d’opinions plus qu’à
l’uniformité d’une vérité toute faite. Le metteur en scène Jean-Michel Ribes
dans un Edito pour présenter la programmation 2019-2020 du Théâtre du
Rond-Point [4] parle
de ces « Espaces vacants »
de l’art qui échappent à la pensée unique :
Mais quelle est alors, cette minuscule plante qui se glisse entre deux parpaings de certitudes révélées ? Ce fragile brin d’herbe qui refuse de mourir sous le béton des choses si importantes ? C’est l’art. L’art à qui l’on ne consacre plus aucun espace vacant. L’art oxygène, l’art qui nous protège des vérités qui tuent et des robots annoncés, l’art pourvoyeur de rêves, l’art de vivre. Vivement que cette petite plante fasse s’écrouler ce mur."
Nos défaites est une expérience artistique de lycéens qui découvrent le cinéma avec un réalisateur hors-champ leur tendant la perche pour qu’ils deviennent les acteurs du monde dans lequel ils vivent. Une confiance précieuse du réalisateur dans les réactions spontanées de ces jeunes répondant à ses questions et une leçon pour découvrir le cinéma comme un art engagé. Un film bienfaisant assurément.
[1] Jean-Gabriel Périot et Alain Brossat, Ce que peut le
cinéma Conversations, Editions La
Découverte, Paris, 2018, p.150
[2] Ibid., p.151
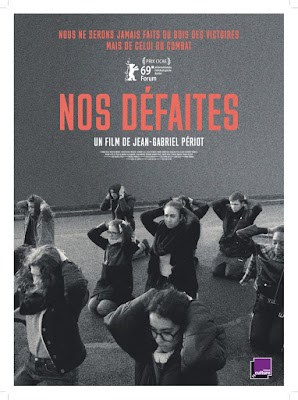






Commentaires
Enregistrer un commentaire